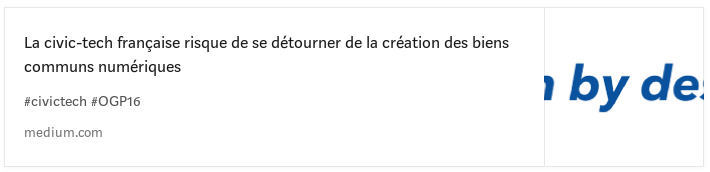Cet article a été rédigé par Valentin Chaput d’Open Source Politics et publié initialement dans le blog d’Open Source Politics, mis à disposition sous licence CC BY-SA 4.0.
Lorsque nous avons créé Open Source Politics, au cœur du bouillonnement démocratique du printemps 2016, nous avions l’habitude de conclure nos présentations en constatant que la civic-tech n’avait encore rien prouvé et que le premier enjeu pour assurer sa progression allait être de trouver un modèle économique pérenne.
Deux ans plus tard, une première sélection s’est naturellement opérée. D’un côté, les démarches citoyennes qui poursuivaient un horizon électoral ont été au bout de leurs expérimentations ; elles formeront le socle de sédimentation des prochaines itérations, avec un besoin crucial d’accès à de nouveaux financements. De l’autre, plusieurs entreprises ont débuté leur phase de croissance en commercialisant avec succès des plateformes et applications auprès d’institutions publiques et d’acteurs privés.
Puisque nous sommes souvent questionnés sur le modèle OSP, nous avons pris le temps, au cours des derniers mois, d’analyser les différentes approches de notre marché en cours de structuration. Une occasion de réfléchir à nos propres spécificités et d’anticiper les conséquences à long terme des choix politiques et économiques qui s’opèrent actuellement.
Indiquons tout d’abord que la recherche d’un modèle de rentabilité n’est pas obligatoire : pour les projets de nature associative, reposant essentiellement sur des contributions bénévoles et militantes, l’appel aux dons philanthropiques et/ou aux subventions publiques peut suffire. Citons l’exemple de l’association Regards citoyens, qui alerte d’ailleurs régulièrement sur les dérives potentielles d’un civic-business.
En revanche, pour que les démarches officielles de démocratie participative bénéficient du potentiel des civic-tech, il est nécessaire d’investir dans le développement d’outils sans cesse plus performants et dans un accompagnement méthodologique professionnel. C’est la voie dans laquelle nous nous sommes engagés avec OSP — sans abandonner nos actions associatives pour autant.
Aux États-Unis, la Knight Foundation en liste huit variantes mais, pour notre part, nous identifions à ce stade 4 grands modèles de financement de notre secteur d’activité : lever des fonds, vendre des données, vendre des licences, vendre des compétences. S’ils peuvent tous se révéler viables et lucratifs à court et moyen terme, ces modèles n’auront assurément pas les mêmes conséquences démocratiques à long terme.
Lever des fonds.
C’est le modèle de financement classique d’une start-up pour accélérer sa croissance. En se projetant sur la réussite économique future d’une entreprise, un investisseur en capital-risque (aussi appelé venture capitalist ou business angel en anglais) va injecter beaucoup d’argent en échange de parts dans une société. Cet apport de liquidités permet à l’entreprise de recruter de nouveaux collaborateurs, d’investir en recherche et développement, de déployer un plan de communication plus ambitieux et d’asphyxier la concurrence dans la logique d’être l’acteur dominant du marché pour empocher à terme une mise quasi monopolistique — the winner takes all.
Nous faisions état fin 2016, à l’occasion du sommet mondial du Partenariat pour un Gouvernement ouvert organisé à Paris, de notre crainte que la civic-tech française, à rebours des tendances internationales, se détourne de la création des biens communs numériques pour s’orienter quasi exclusivement vers le financement de logiciels propriétaires.
Notre diagnostic est en train de se réaliser puisque certaines des “entreprises civic-tech” françaises les plus visibles ont levé plusieurs millions d’euros au cours des six derniers mois. Ainsi ont-elles pu doubler leurs effectifs en quelques mois et intensifier leur communication, parfois conjointe, à destination des institutions et du grand public.
Lever des fonds n’est pas un problème en soi, bien au contraire, mais ce n’est en réalité qu’un financement temporaire pour accélérer la mise en place du véritable business model d’une entreprise. Par conséquent, la question essentielle est bien celle-ci : quel est le modèle économique qui a convaincu des investisseurs publics et privés de s’engager auprès de ces acteurs de la civic-tech ?
Vendre des données.
Dès juin 2015, à l’occasion d’un test de l’application américaine Brigade, qui était présentée comme le “Tinder de la démocratie”, le potentiel économique du big data politique était perceptible. Les plateformes qui collectent dans leurs bases de données nos opinions sous forme de réponses à des micro-sondages ou de signatures de pétitions se constituent de véritables mines d’or dans notre dos.
Quand bien même elles se défendraient de le faire aujourd’hui, quelles garanties ces entreprises nous apportent-elles qu’elles n’exploiteront pas demain ces données à des fins commerciales, quand le niveau de l’offre et le besoin de trésorerie seront trop irrésistibles ? Les décideurs politiques, les journalistes et les grands acteurs économiques, qui investissent déjà des fortunes dans les mesures de l’opinion effectuées par les instituts de sondage, n’attendent que cela : des outils qui permettent de cibler précisément un segment de la population pour lui adresser le contenu qui lui plaira au regard de son historique politique et qui assurera ainsi le succès d’une élection ou d’une entreprise de lobbying.
Deux expériences concrètes du pouvoir discrétionnaire de ces plateformes ont levé nos derniers soupçons.
Lors de la récente consultation “Démocratie numérique” dont nous assurions la modération et la synthèse pour l’Assemblée nationale, un tiers du trafic global enregistré sur la plateforme est provenu d’un lien direct vers sa propre proposition que Change.org a partagé avec 1,5 million de fans sur Facebook et adressé par email à ses 500 000 utilisateurs les plus intéressés par les questions institutionnelles. Logiquement, cette proposition fut de très loin la plus populaire (quasiment 20% de l’ensemble des votes exprimés sur un total de 1700 contributions). En un seul message ciblé, Change.org a eu plus d’impact qu’un mois de communication quotidienne de l’Assemblée nationale sur ses réseaux sociaux et que la dizaine d’entretiens du président de l’institution et de plusieurs député-e-s, pourtant relayés par nos plus grands médias écrits, radio et télévisés ! C’est formidable pour de nombreuses causes qu’une plateforme comme Change.org ait atteint une telle masse critique, mais un si grand pouvoir impose de grandes responsabilités.
Dans le cadre de missions d’accompagnement de concertations publiques locales, nous avons par ailleurs eu l’occasion de diffuser des “Facebook Ads”. Il s’agit de publications sponsorisées dont nous avons pu calibrer l’audience avec une précision redoutable : en échange de quelques dizaines d’euros, nous pouvions placer l’invitation à une réunion publique ou le lien vers un questionnaire sous les yeux des quelques milliers d’utilisateurs de Facebook résidant dans tel ou tel quartier, correspondant à telle ou telle tranche d’âge et ayant démontré par leurs likes un intérêt pour tel ou tel sujet.
Si l’échantillon est assez conséquent, l’investissement est considérablement plus efficace — notamment auprès des jeunes citoyens — que la diffusion de tracts sur le marché ou l’envoi d’un courrier dans les boîtes aux lettres. Le problème, c’est que Facebook limite volontairement la portée des messages pour nous inciter à rajouter quelques euros en échange d’un affichage plus important. Les plateformes de pétitions fonctionnent de la même façon : payez 10 euros pour que votre pétition soit directement envoyée à 1000 signataires potentiels supplémentaires. Et ainsi de suite.
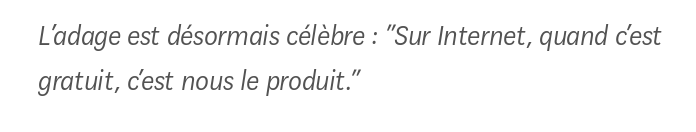
Dans une “économie de l’attention” où il est de plus en plus difficile de faire passer un message à caractère civique hors des bulles d’initiés déjà convaincus et impliqués, la définition de l’ordre du jour démocratique peut-elle ne plus dépendre que des filtres payants imposés sans transparence ni contre-pouvoir par des plateformes privées ?
Vendre des licences.
Une mauvaise traduction de “free software” induit en erreur de nombreux interlocuteurs qui nous sollicitent : ce n’est pas parce qu’un logiciel est libre qu’il est gratuit.
Sans même parler du développement du logiciel, l’utiliser présente des coûts de déploiement, de configuration, d’hébergement et de maintenance. Inversement, une fois qu’il est développé et en dehors des coûts précités, la duplication d’un logiciel a un coût marginal nul. Le développement ayant déjà été financé et réalisé, n’importe qui peut en bénéficier. En échange, il faut investir dans les prochaines évolutions, qui bénéficieront en retour à tous. À l’inverse, dans le cas d’un logiciel propriétaire, il est nécessaire de payer une licence d’exploitation pour un logiciel qui existe déjà, afin de rentabiliser l’investissement initial comme dans le cas d’un produit manufacturé. Au passage, en cas de position dominante tendant vers le monopole, il y a fort à parier que vous allez payer de plus en plus cher puisque vous n’avez pas d’alternative.
Ainsi l’État français a-t-il payé de plus en plus cher pour utiliser une même plateforme propriétaire. Au lieu de faire monter en compétences les administrations dans la gestion d’une solution de base et d’investir dans son amélioration — quitte à confier cette dernière à des entreprises de développement privées — la puissance publique accepte de payer, licence après licence, une plateforme dont elle ne maîtrise ni le code source ni la stratégie d’évolution. De manière cocasse, c’est déjà un investissement public, via une participation de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui finance en partie le développement de cette solution qui prive L’État de sa souveraineté en matière de démocratie participative en ligne !
Recourir à l’offre Software as a Service (SaaS) d’une entreprise qui a fait ses preuves est un choix confortable qui déresponsabilise les décideurs et les équipes techniques des ministères et des collectivités territoriales. Il présente selon nous — et nous le disons en tant que citoyens au-delà des intérêts concurrents de notre entreprise — un risque majeur de privatisation d’outils et de compétences qui doivent au contraire être partagés avec le plus grand nombre.
Faudrait-il au contraire que l’État crée sa propre plateforme ou rachète les droits de celle de son prestataire privilégié ? Ce serait potentiellement tout aussi grave, dans l’hypothèse imprévisible d’un gouvernement aux pratiques liberticides qui se servirait de telles plateformes pour un fichage des opinions des participants ou une modification a posteriori de leurs contributions. C’est notamment la position de nos inspirateurs barcelonais qui ont conçu la plateforme Decidim dont nous sommes partenaires. Virgile Deville a développé cette argumentation début décembre 2017 lors d’une conférence du think tank Décider Ensemble autour des rapports d’institutionnalisation ou d’indépendance entre civic-tech et démocratie représentative.
Chaque choix de design et d’intégration effectué par une équipe technique sur une plateforme a, même inconsciemment, un impact sur les utilisateurs. Prenons un exemple : le fait de connaître le résultat d’un vote avant de participer modifie nos comportements. Avec un logiciel libre, nous pouvons avoir un débat sur le fait de donner accès ou non à cette information aux participants — quitte éventuellement à développer les deux options. Dans le cas d’un logiciel propriétaire, un module de visualisation des avis positifs, neutres ou négatifs participe d’une offre globale à prendre ou à laisser car ces choix décisifs ont déjà été arbitrés par les développeurs qui, in fine, contrôlent le sens de votre processus participatif. Code is Law.
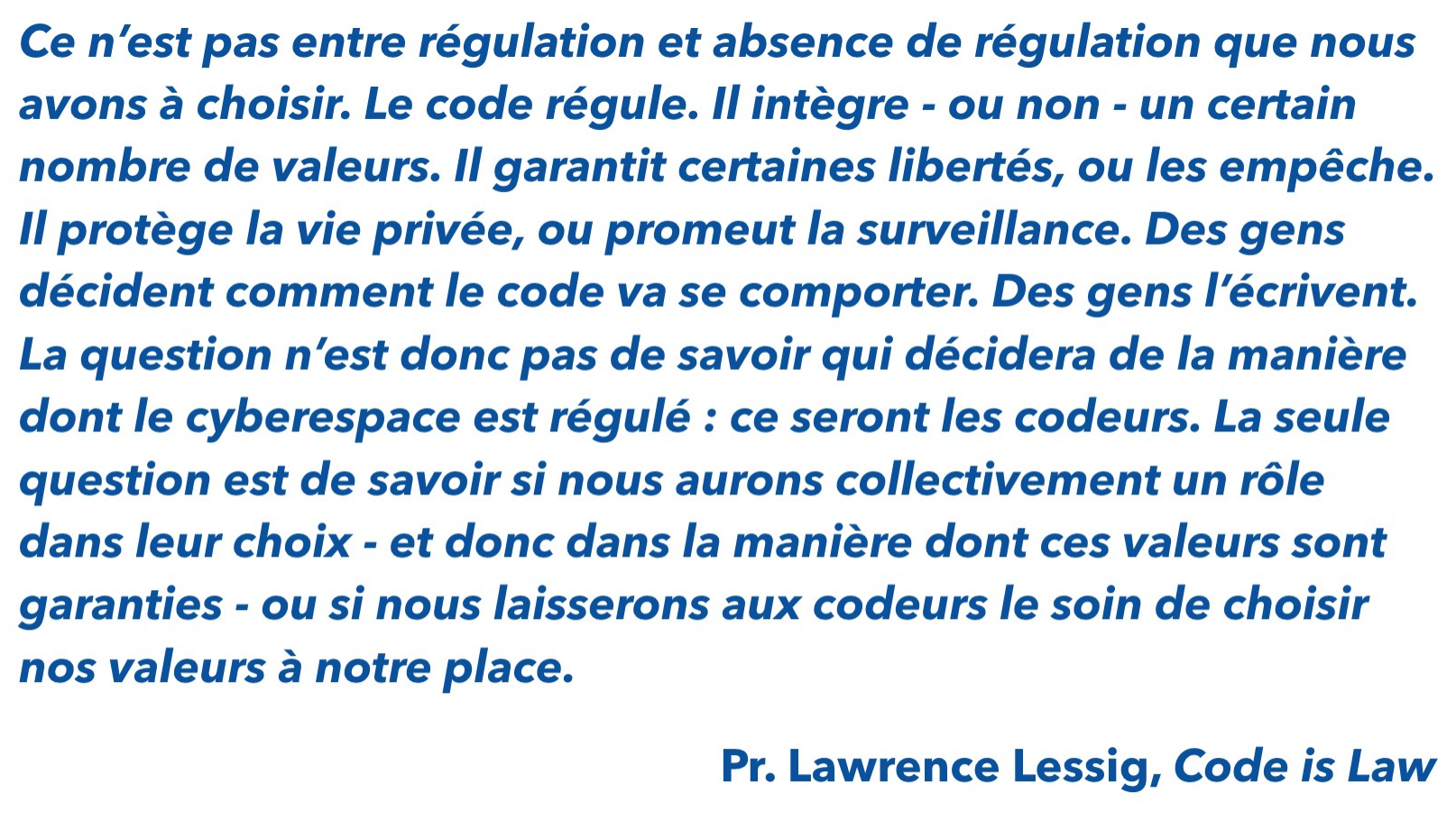
Vendre des compétences.
Que faire alors ? Comment financer des outils numériques réellement démocratiques ? Le processus de création d’un bien commun viable est assurément plus lent, mais à terme il est considérablement plus vertueux et plus résilient.
L’Assemblée Nationale vient de montrer l’exemple : à l’automne 2017, elle a fait appel à Open Source Politics pour la conseiller dans la configuration et l’utilisation d’une instance DemocracyOS que son équipe technique a appris à utiliser et à déployer sur les serveurs sécurisés de son propre hébergeur. Elle est désormais libre de mener autant de consultations sur DemocracyOS qu’elle le souhaite avec ses propres ressources. Autre avantage, l’Assemblée Nationale a pu missionner Open Source Politics pour analyser les contributions sans que nous ayons accès à la base de données en cours de consultation, et donc sans que nous ayons aucun moyen d’altérer les contributions des citoyens. L’Assemblée Nationale a tiré les conclusions de son utilisation et émis un cahier des charges pour des évolutions fonctionnelles souhaitables avec un horizon de plusieurs mois. Une instance démocratique — le Bureau de l’Assemblée Nationale — a validé certaines de ces évolutions et commandé leur réalisation. L’investissement de l’Assemblée nationale bénéficiera à n’importe quelle institution et n’importe quel collectif citoyen qui voudra s’en saisir, partout dans le monde.
Voilà ce qu’est un bien commun numérique. Voilà ce que doit être un investissement public dans un code public.

Quel est l’intérêt d’Open Source Politics si nos clients peuvent se passer de nous dès que le transfert de compétences a eu lieu ? En réalité, ce modèle est totalement cohérent avec le modèle qui consiste à vendre de multiples prestations : héberger et maintenir un outil pour les clients qui n’ont pas les ressources internes suffisantes, développer de nouvelles fonctionnalités lorsque nos clients financent ces améliorations qui seront mutualisées, enfin accompagner l’usage de ces technologies par des formations, des supports de communication, du conseil stratégique, de la modération et de l’analyse…
Depuis le printemps 2016, nous avons élargi notre champ de compétences à l’animation d’ateliers d’intelligence collective et au traitement automatique du langage, afin de comprendre toutes les étapes d’un processus démocratique ouvert et moderne, en ligne et hors ligne. Nous ne vendons pas un bien captif ; nous partageons un savoir-faire. La plateforme de participation n’est qu’un outil, une partie d’un processus qui se heurte encore à des barrières sociologiques et cognitives qui excluent de la participation une large partie de la population. De même que les plateformes n’évoluent pas en un claquement de doigts, la participation citoyenne ne se décrète pas en un jour.
Il faut, pour reprendre une formule issue d’une réunion de travail avec la mairie de Nancy, donner aux citoyens du pouvoir, du sens et du temps. Du pouvoir, pour qu’ils décident vraiment : 2300 parents d’élèves et enseignants nancéiens ont participé à la première votation en ligne sur l’évolution des rythmes scolaires ; le maire a suivi leur décision. Du sens, pour qu’ils comprennent les démarches auxquelles ils prennent part : grâce à un intense travail de terrain, 14 % des locataires ont voté au premier budget participatif de la RIVP — un record. Du temps, pour que l’habitude se crée et que la confiance se gagne : depuis deux ans, la mairie de Nanterre a pu mener plus d’une dizaine de campagnes de concertation successives pour élargir progressivement le profil des citoyens impliqués.
Notre code commun.
Nous abordons les défis qui se présentent à nous avec beaucoup d’humilité. Les plateformes civic-tech sont encore largement perfectibles, les pratiques démocratiques sont fondamentalement à repenser. Depuis le premier jour, nous avons désiré construire une entreprise qui nous ressemble et qui soit alignée avec nos valeurs. Nous avons encore tant à faire, mais nous ne sommes pas seuls et nous savons ce dont le collectif nous rend capable.
Autour de nous, des partenaires géniaux s’engagent pour que le modèle d’une démocratie réellement ouverte existe et nous les remercions pour leur soutien — citons par exemple Entr’ouvert et sa solution de gestion de la relation usager Publik que nous voulons rendre interopérable avec nos plateformes, La MedNum qui soutient les nouveaux modèles de développement de l’innovation en partenariat avec les territoires ou Medias-Cité qui porte la création des chèques APTIC pour diffuser les compétences des acteurs de la médiation numérique auprès de tous ceux qui en ont besoin.
Autour de nous, une vingtaine d’institutions francophones s’apprêtent à rejoindre une communauté d’utilisateurs qui réfléchit et investit de concert dans le futur de nos outils… en partageant avec les mairies de Barcelone, Helsinki et Turin, avec les gouvernements d’Argentine ou de Belgique.
Autour de nous, et nous vous en avons déjà présentés quelques-uns, des chercheurs et des militants du monde entier se mobilisent, non pas pour construire de nouvelles rentes économiques, mais pour faire de la démocratie du XXIe siècle notre bien commun.
Retrouvez l’article original ici